



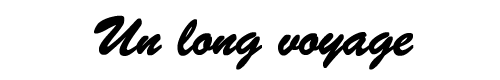
.......C’était une triste époque de 1938 à 1940. L’avenir n’était pas brillant, on ne parlait que de guerre. Les Allemands étaient de plus en plus puissants et conquérants : la Pologne était déjà anéantie et d’autres y étaient aussi passés. En septembre 1939, c’était notre tour. A cette époque je travaillais aux aciéries de Pompey, en Lorraine, à douze kilomètres de Nancy, dans un atelier de réparation de locomotives. Juste à la limite de la ligne SNCF de Nancy à Metz et de la frontière, les trains passaient à dix mètres à peine de mon atelier. La mobilisation était déclarée, il y avait des affiches de rappel des classes dans tous les coins de la ville. En moins de deux jours, la moitié des ouvriers avaient quitté l’usine. La troupe montait sans arrêt par la route où trains ; camions, canons et soldats passaient. Les autos des civils étaient réquisitionnées, une couche de peinture brun noir et verte, et en route pour la guerre. Elles ne nous appartenaient plus, nous n’avions même pas d’argent, juste un vague papier sans valeur.
.......Le soir même de la déclaration de guerre, le premier bombardement se fit entendre, toute la population se rua dans les bois. Cela commençait bien, et cela jusqu’en Mai, heureusement pas tous les jours. Je me souviens de ces bombardements de nuit ; d’abord les fusées éclairantes lancées des avions puis, dans un bruit d’enfer, avec les moteurs à fond, de véritables sirènes montées sur ces avions hurlaient et vous glaçaient le corps. C’était des Stukas, avions de chasse allemands. Il y avait d’abord les petites bombes, et ensuite le mitraillage au hasard, cela partait de partout. Je me souviens d’une nuit où ça tapait dur, vers notre maison de cité ouvrière.La chambre de ma sœur, en dessous de la mienne, a été criblée d’éclats traversant les épais volets en bois, cassant les vitres, et rentrant dans la chambre. Une bonne peur de plus, il était temps de se mettre à l’abri. Tout le monde au boulot, il n’y avait pas de fainéants. A l’usine, c’était la même chose devant chaque atelier, tout le monde creusait pour se mettre à l’abri. Dans la journée, c’était le vol des Messerschmitts. L’usine était toujours visée mais il y avait peu de dégâts. Beaucoup de bombes descendaient sans exploser. Il y avait un trou de dix mètres en terre. Même une bombe dans le quartier du Jeuyeté, à coté de l’usine, est descendue au beau milieu de la maison, coupant au rez de chaussée le couloir, pour aller finir sa course dans la cave sans exploser. Mais il fallait évacuer le coin, bombes à retardement soit disant. Cinq ans après mon retour au pays, il n’y avait toujours pas d’explosion.
.......Je reviens donc aux trains qui passaient toutes les demi-heures, pleins de troupes et qui redescendaient avec les habitants de la frontière, évacués de force, jusqu’aux Pyrénées, les Landes. Ayant tout laissé sur place; ils partaient juste avec une valise, beaucoup de tristesse et de pleurs. C’est une chose que je ne voudrais voir une autre fois, et pourtant au bout de cinq ans, ils sont revenus. Beaucoup manquaient à l’appel. Ils ont retrouvés leurs maisons, mais vidées entièrement par la troupe, plus rien que des murs. J’ai vu ces trains passer à dix mètres de moi, il y avait de tout ce qui faisait un intérieur : des salles à manger, à coucher, des vélos, des motos, et autres biens raflés par l’armée française. Que l’on ne vienne pas me dire maintenant que j’ai inventé tout cela, il y a des témoins, tout était camouflé, pas un mot dans les journaux de l’époque. C’était un pillage à grande échelle, car des jeunes et des vieux non mobilisables ont vus cela se passer.
L’hiver est arrivé, toujours pas d’Allemands, beaucoup de permissionnaires ; la peur de la guerre s’atténuait. A l’usine, il fallut embaucher des femmes ; alors là, quelle pagaille et quelle débauche ! elles venaient au travail en robe, gênées de se trouver mélangées aux hommes. Mais en moins de huit jours, toutes étaient en salopettes, fumant comme des pompiers, et jurant comme des charretiers, sans oublier leurs petites bouteilles de gnôle. Et tout ce monde à faire des obus dans la fonderie et sur des machines pour la finition. L’ambiance n’était plus de chahuter avec elles, sinon en moins de deux les insultes. Elles se défendaient comme elles pouvaient. Elles ont travaillé dur dans les ateliers, il faut reconnaître que sans elles, l’usine fermait. Je ne suis pas resté longtemps avec elles car le réveil a été dur pour tous. De bon matin, le 14 Juin 1940, le garde champêtre au son de son tambour annonça à tous les coins de rue de la ville que tous les jeunes de 18 ans et plus devaient quitter le pays par leurs propres moyens, et se rendre à la gendarmerie de Mirecourt (Vosges), car les fridolins venaient de franchir la frontière et déboulaient à grande vitesse. Là-bas, nous étions mobilisés, il fallait filer. Déjà sur les routes, c’était un lent défilé à pied, autos, chevaux et vélos ; c’était un bric-à-brac dans les voitures et les camions : des matelas sur les toits, des valises et tous les autres biens qu’ils pouvaient fourrer dedans. Et les convois pleins de soldats qui foutaient le camp.
.......Quatre copains et moi, de la même rue et du même âge, chacun son vélo et en route, mais pas moyen d’avancer avec cette cohue, il y en avait partout et il en arrivait de plus en plus. Des arrêts brusques de camions et voitures ; je suis même rentré dedans avec mon vélo ; fourche et cadre tordus mais ça roulait quand même. Lorsque nous fûmes enfin arrivés à Mirecourt, les gendarmes avaient foutu le camp depuis longtemps. Le temps pour nous de ranger nos vélos chez une tante de mon copain, et en route, les vélos ne servaient plus à rien. Les voitures non plus, toutes étaient abandonnées, les radiateurs étaient à sec, ou il n’y avait plus d’essence, cela fumait de partout. Plus loin se trouvait des valises abandonnées avec de biens belles choses : lingerie fine, services de table en argent, des uniformes de l’armée ainsi que des sacs à dos. Nous en avons récupéré chacun un pour remplacer nos valises. Dans le mien, il y avait de quoi se raser mais pas de glace, j’ai même trouvé une combinaison d’aviateur en cuir, cela m’a bien servi plus tard pour les nuits. Il y avait même des demi bottes en cuir que j’ai délaissées. Je l'ai regretté, car mes chaussures ont rendus leur âme la deuxième journée en cours de route. Il n’y avait pas souvent de toits, ni d’endroits pour se cacher, et parmi tous ces gens il fallait se soulager de temps à autre. Et là, un triste spectacle : hommes, jeunes filles, plus de pudeur. Il a fallu s’y habituer, que de postérieurs à l’air, un vrai troupeau qui avait perdu toute trace de bonnes manières. Bien sûr, ils étaient gênés de faire cela devant tout ce monde. Et pour tous, les chaussures et les pieds gonflaient, les semelles lâchaient. Beaucoup de gens rafistolaient cela avec des serviettes ou ce qu’ils avaient. Les miennes ont lâché le lendemain. C’était l’enfer sur la route, beaucoup de personnes n’en pouvaient plus, les personnes âgées les premières. Elles étaient hébétées.Pour elles, c’était la fin du voyage. Il y avait aussi beaucoup d’enfants perdus, des appels de parents. La nuit venait et cela marchait toujours, j’ai tenu le coup jusqu’à minuit, et là mes jambes ont lâché. Quinze heures sur la route, je n’en pouvais plus . Sur le bas côté nous avons dormi mes copains et moi, sans couverture ni matelas, à même l’herbe avec les odeurs et les excréments comme voisins. Au petit jour, les gens passaient toujours, il a fallu remettre cela. Dur, très dur de se remettre sur pied, ni eau ni rien dans le ventre depuis la veille au matin. Pas moyen de se ravitailler, tout était fermé. Le cerveau était vide lui aussi. Une nouvelle journée à marcher. Où étions nous ? Nous allions bientôt le savoir en fin de matinée.
.......Les avions Allemands firent leur apparition, des Stukas plongèrent dans un hurlement de sirènes et moteurs à fond, et les balles commencèrent leur carnage. Les camions militaires en feu, des morts partout. Je me souviens d’une cabane de cantonniers sur le bas côté ; nous étions bien une centaine à tourner autour car un de ces avions nous avait pris pour cible. Les balles crépitaient autour de nous. Une chance pour moi, je ne pouvais pas en dire autant de ces pauvres gens fauchés comme des lapins. Pour eux, l’exode était terminé.Qui s’est occupé d’eux ? Je l’ignore. Deux fois dans la journée, ils sont revenus pour tuer, et ce jour fut le même que le précédent. Parfois une autre route croisait notre chemin avec autant de monde. Les arrêts étaient interminables et il fallait trouver une place parmi eux et il y avait toujours ce soleil qui tapait. Nous avons marché toute la journée jusqu’à minuit, cherchant un coin pour dormir. Enfin nous avons trouvé un hangar dans un pré mais il était plein à craquer. A force de chercher avec notre lampe de poche, j’ai trouvé un emplacement entre une dame âgée et une jeune fille. Après m’avoir aidé pour la place, je les ai remerciées, nous avons parlé un peu mais, tout à coup le sommeil m’a rattrapé et je me suis endormi. Après une journée d’enfer, il m’est pourtant arrivé une bien belle chose : à la pointe du jour, les gens repartaient bruyamment et l’on sentait des pieds qui nous écrasaient. Et ce qui reste encore un mystère pour moi, c’est que la jeune fille dormait dans le creux de mon épaule, mon bras sous sa tête. Qui, dans notre sommeil, a fait le premier pas ? Lequel s’est approché de l’autre ? Je n’ai toujours pas de réponse encore maintenant, après 60 ans. Elle était bien dans cette position et moi j’étais ravi bien sûr. Je lui ai posé un doux baiser sur la joue, ce qui l’a réveillée. Elle était très gênée et troublée de se trouver dans cette position. Après mille excuses de part et d’autre, il a fallu reprendre la route avec ce beau souvenir au cœur. Qui était-elle? Je ne lui ai pas posé la question car à l’époque, j’avais un peu peur des filles. Puis, j’ai retrouvé les copains en route. Nous avons encore parcouru des kilomètres toujours à pied, jusqu’à un croisement où il y avait un convoi militaire. Des camions d’hommes et dix autobus tous neufs étaient réquisitionnés par l’armée. Les gens ont tout pris d’assaut malgré le refus des militaires. Nous étions de retour sur la route mais nous avancions lentement. Il y avait tellement de gens qui traînaient les pieds après tous ces kilomètres. Combien avaient abandonné en chemin? Nous avons trouvé une place à l’avant du bus. Par chance, j’étais derrière le chauffeur. Nous allions entrer dans un petit village encore lointain lorsque les premiers coups de canon furent lâchés. Très vite, tout le monde était descendu et courait dans les champs. Je n’ai pas eu le temps de savoir quelle herbe poussait là, blé ou orge. C’était haut et entre chaque rafale, nous filions plus loin. Mais les balles qui arrivaient nous obligeaient à nous plaquer au sol. A côté de moi était allongée une femme avec son bébé dans les bras. Soudain, elle s’est redressée et là, un drame atroce s’est produit : un obus lui a coupé la tête et elle s’est écroulée sur moi, pleine de sang. J’ai cru devenir fou ce jour-là. Que de cauchemars les nuits suivantes ! Encore maintenant je me réveille en sursauts, je vois encore la jeune femme sur moi. Quelle horreur cette saleté de guerre ! D’autres tirs ont suivis, puis plus rien. Avec mes copains, nous avons porté le corps jusqu’au bus. Quant au bébé, quelqu’un de son entourage s’en est occupé. Je suis remonté dans le bus pour chercher mon sac, et là, une autre chance pour moi, un obus avait traversé la vitre. Le chauffeur et moi aurions pu être tués mais l’engin était allé s’encastrer dans le dossier du siège et n’avait pas explosé. J’ai souvent vu leurs premiers obus qui n’explosaient pas. Pourquoi? Cela m’avait encore sauvé. Ce n’était pas mon jour, mais j’en ai vu encore de bien plus horribles. Dans ce bus, les militaires avaient récupéré un cochon qui était vivant mais sale et puant. C’est en passant devant le rétroviseur du chauffeur que j’ai vu qu’en fait, j’étais aussi sale et puant que ce cochon. Cela taisait trois jours que nous souffrions sur les routes ; la sueur, la poussière et le sang sur nos corps n’arrangeaient rien. J’avais besoin d’un bon bain. C’est alors que quatre Fritze sont arrivés en bas du chemin, mitraillettes, grenades à manche, masques à gaz à l'arrière, et les gueulements ont commencés. Ces gens ne savent pas parler, ils gueulent.
.......Il y avait un rassemblement vers un village à flanc de colline : Champlitte en Haute Saône. Mais comme nous avions des sacs militaires, ils ont rassemblés tous les soldats et nous avec, qui étions dans cette colonne de réfugiés, et en route vers une maison vide en face du Château mairie. Nous avons traversé un petit ruisseau et là, nous n’avons pas hésité, pas le temps de nous déshabiller car un bon lavage pour nous tous et pour soulager nos pauvres jambes faisait le plus grand bien. Mais ces salopards de verts et de gris nous ont sortis de là à grands coups de crosses de fusils dans les reins. Je commençais à en avoir plein le dos de ces bandits. Après bien des hurlements, nous avons été sur cette place où ils nous ont fouillés. Toutes les armes, fusils, revolvers, menottes des gendarmes et bien d’autres choses étaient posés en tas devant la maison. Nous avons balancés nos masques à gaz, nous crûmes que le calvaire était terminé. Mais ils nous ont encore fait marcher jusqu’à Langres. Nous n’en pouvions plus. Ils nous ont fourrés dans une énorme grange pleine de foin. A Longeau nous venions de parcourir 25 kilomètres depuis Champlitte ; sans compter les 30 kilomètres d’avant. Nous passions de sacrées journées. Où avions nous trouvé toute cette énergie pour faire tous ces kilomètres ? Je me le demande encore surtout avec des souliers rafistolés avec des chiffons que nous avions récoltés sur les bas côtés de la route. Au matin, ce n’était pas les Fritze qui nous avaient réveillés mais tout un troupeau de vaches qui beuglaient à plein poumons. Cela faisait au moins trois jours qu’elles n’avaient pas été tirées. J’ai bien essayé de les traire mais le lait ne coulait pas. Et nous avions toujours aussi faim et soif. Puis de nouveau sur la route, en queue de convoi, deux autos mitrailleuses arrivèrent, en vue de Langres. Elles étaient venues nous encercler mais comme nous étions loin à l’arrière et en civil, ils nous ont oubliés. Toute la colonne est entrée dans la citadelle, par le haut de la ville, mais nous avons contourné les remparts pour entrer dans la ville par la dernière porte. Elle donnait sur une place avec en face la mairie transformée en Kommandantur qui grouillait de Fritze. Ce n’était pas la peine de se faire coincer de nouveau, il y avait justement un café ouvert et vide, tenu par une alsacienne et une jeune fille du coin. Boire en premier, quel régal ! Ensuite il fallait manger, mais il n’y avait aucun ravitaillement. C’est à ce moment qu’une Mercedes s’est arrêtée devant le café. Six officiers sont entrés pour boire. Nous nous faisions très discrets mais ils n’en avaient pas après nous, même si tous les cafés étaient réservés à la troupe et rien que la troupe. La patronne leur a parlé en allemand. Ils nous ont bien regardés puis l’un d’entre eux est sorti pour fouiller dans la voiture. Et là, nous avons dû collaborer avec eux car la patronne mettait à chauffer des conserves. Je me souviens encore de cette copieuse choucroute que nous avons vite avalée et bien d’autre chose. Nous étions rassasiés. Plus rien ne passait surtout que nous ne voulions pas avaler de la nourriture provenant d’eux (nous avions déjà peur d’être empoisonné). Si nous avons mangé, c’est bien parce que notre estomac criait famine, il a ensuite fallu trouver un endroit pour dormir. La jeune servante nous a emmenés chez sa mère, un peu plus loin. Celle-ci nous a acceptés de bon cœur dans une maison abandonnée par les propriétaires qui avaient suivi le convoi de l’exode. Il a fallu dix jours pour nous remettre. Nous ne savions pas comment nous nourrir car il n’y avait rien. Mais il fallait manger, et je ne sais quelle bassesse nous a prit, j’ai même honte de l’écrire, mais à tour de rôle nous allions quémander à la cuisine roulante Allemande de quoi remplir nos gamelles. Ça ne marchait pas toujours. Aussi, nous revenions à chaque fois avec un pain noir de l’armée Allemande. Il a fallu s’y habituer à cette saleté de pain noir ! Mais il fallait encore marcher et il fallait avoir un laissez-passer signé de la Kommandantur. Ça a marché, mais moi je n’avais plus de chaussures. Comment faire ? A force de marcher dans la ville, j’ai trouvé un magasin. Il était ouvert ou plutôt forcé. Personne ne répondant à nos appels, la seule solution était de se servir. J’ai choisi une bonne pointure au-dessus et en route. Il fallait se dépêcher, mais alors là, une mauvaise surprise : une patrouille armée arrivait sur nous. Je n’ai pas attendu qu’ils me ramassent une deuxième fois. Une course folle démarra à travers les ruelles de la ville. Mais ils ont commencé à nous tirer dessus. Je n’ai jamais couru aussi vite de ma vie surtout que j’étais pieds nus, la boîte à chaussures dans les bras, ils nous avaient loupé, c’était une chance. Le lendemain, départ pour le retour au pays. Auparavant, nous avions fait une visite à l’alsacienne du café en lui montrant notre Ausweis écrit en allemand. Mais nous devions encore faire ces 150 kilomètres uniquement à pied, Aucune voiture, ni train, il a fallut revoir notre ravitaillement : quelques magasins avaient rouvert. Des conserves, du pain noir et en route ! Il n’y avait personne sur les routes, et c’était mieux comme ça. Nous faisions une moyenne de 40 kilomètres par jour, mais à chaque entrée et sortie des villages traversés : « Halte, papiers ! ». Il y en avait partout, pire que des doryphores sur un plan de pommes de terres. Nous n’en menions pas large après ce que nous avions subi : bombardements, mitraillages, des chars qui nous ont tiré dessus, les fusils qui nous prenaient pour des lapins, nous en avions par-dessus la tête de ces gens-là. A force de marcher, le troisième jour, nous avons été dépassés par un gros cheval avec un tombereau à bascule. Sur notre papier, ils ne parlaient pas de cheval, alors d’un bond, tous les cinq dans le véhicule. C’était un militaire en civil, un parisien qui l’avait volé et il rentrait à Paris. Nous avons fait une dizaine de kilomètres ensemble. On rencontrait beaucoup de convois et de chars allemands. Et soudain, nous remontions un convoi à l’arrêt et voilà notre cheval qui prend peur et accélère de plus en plus. Toutes ces secousses sur la route ont fait sauter la goupille de blocage. Voilà notre carriole qui s’élève. Et nous sommes descendus par la trappe arrière devant les allemands qui se tordaient de rire pendant que notre Percheron s’emballait et disparaissait au loin. Nous n’avions plus de monture. De nouveau à pieds, il fallait encore marcher sous le soleil avec ce nouveau compagnon. Nous n’étions pas loin de Charmes et dans un petit bois, nous avons trouvé un convoi de véhicules abandonné de l’armée française. Nous nous sommes mis à fouiller immédiatement pour trouver de la nourriture. Et là, je ne sais ce qui m’a pris, j’ai pris deux revolvers et des cartouches. Et cela au risque de me faire fusiller si il y avait eu une fouille des sacs. Mais la chance devait être avec moi, personne n’a fouillé les sacs. En cours de route, le Parisien cherchait un moyen de rentrer à Paris. Il y avait pourtant le choix. Et il est arrivé avec une Citroën avec deux places à l’avant. Mais personne ne savait conduire. Nous sommes quand même monté tous les six. Et j’ai bien cru que nous allions mourir. De droite à gauche et de gauche à droite, il fallait vraiment se cramponner. On voyait de la fumée sortir de la voiture. Le poids était trop important pour une si petite voiture. Ça ne pouvait plus durer. Et arrivés en haut d’une côte, la voiture a sauté et le moteur a calé juste au moment où deux explosions se sont fait entendre dans le bas. Et la voiture n’a pas voulu redémarrer. Nous l’avons poussée dans la descente, en zigzaguant. Dans le bas, les Allemands venaient de faire sauter un pont. Mais le Parisien tenait vraiment à la voiture, alors nous l’avons poussée jusque dans une propriété boisée mais pleine de réfugiés. C’est là que nous avons passé la nuit à la belle étoile. Au réveil, voilà notre Parisien qui arrive en courant en nous disant qu’il avait trouvé une autre voiture. Nous l’avons suivi jusqu’à un garage ouvert. Il est monté dedans juste au moment où le propriétaire arrivait avec un fusil. Nous avons filé en vitesse sans la voiture, avec des coups de fusils qui nous frôlaient. De nouveau sur la route avec beaucoup de gens qui rentraient eux aussi chez eux, nous avons traversé Vittel où nous avons acheté six tranches de viande crue. Puis, il y avait un café devant nous. Nous sommes entrés et avons demandé au patron de nous les faire cuire. Et là, il nous a dit: “Dehors!”. Et oui, le café était réservé à la troupe, il nous a servi sur le trottoir. Et à mon avis, il a dû se venger sur la viande, car il avait dû verser dessus toute sa réserve de sel. Nous étions donc à Vittel, ville d’eau, et pas moyen d’en trouver. Si bien qu’à la sortie de la ville, nous sommes allés chez une dame pour boire un verre d’eau. Mais il fallait payer quinze francs le verre, ce qui faisait trois fois notre salaire horaire à l’usine. C’était une honte : nous avons eu deux affronts dans cette ville et depuis cela, je n’y suis jamais retourné et je n’ai jamais bu une Vittel.
.......Enfin, Nancy en vue. Le Parisien nous a quitté direction Paris à pied. Il restait douze kilomètres avant d’arriver chez nous. La nuit venait. Et arrivés devant la Moselle : plus de pont ! Tout avait sauté et il n’y avait aucun moyen de traverser le fleuve. Il a fallu coucher dans l’arrière salle d’un café et attendre qu’une barque passe. Nous avons tout de même réussi à rentrer chez nous. C’était la fin de ce long et triste voyage avec tous ces milliers de pauvres gens qui ont souffert bien autant que nous. Les mitraillages, la faim, la soif et la souffrance nous avaient épuisés. Et combien de manquants au retour ? Combien de tués par ces barbares ? Si certains Allemands ont souffert, nous autres Français y avons laissé beaucoup. Je suis passé par là avec mes copains. C’était terrible et ce n’était que le début de cette sale guerre qui a tout détruit. Quatre ans de malheur, avec en prime les camps de la mort, mon beau-père et son fils qui ne sont jamais revenus, comme tant d’autres hélas! Tout comme mon cousin germain qui a été fusillé devant ses trois enfants. Je me demande pourquoi je rouvre cette plaie, car plus personne ne parle de cela, maintenant. A quoi bon puisque personne ne nous croit. C’est trop lointain et pourtant cela a bel et bien existé. Je ne souhaite à personne de passer par ce genre d’épreuves. Je me demande encore comment nous avons fait. Et ce que nous avons vu a changé notre caractère. Malheureusement, les souvenirs reviennent à la surface et c’est terrible d’évoquer tout cela après soixante ans.
.......Je n’ai rien inventé, j’ai toujours des copains qui étaient présent dans ce long voyage. Je n’ai rien d’un romancier, j’ai écris ce que nous avons vécu. Ma prose est à corriger bien sûr. L’école, pour moi, est loin...
................ Des témoins ...
Robert Rambour
Jacques Marchand, mon voisin
René Martzel
Tous trois de Pompey (54) et un autre dénommé Marquant
ainsi que moi-même Georges Cadé avec mes souvenirs. (écrits en 2001)
