



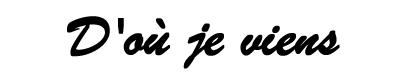
.......Pour mes enfants si cela les intéresse, je suis un enfant de la Lorraine tant de fois meurtrie par des invasions et guerres, dans un petit village au pied de son château ancestral fortifié, tant de fois rasé et reconstruit, un pays de vignes avec sa rivière, la Moselle qui serpente entre les collines de Frouard, Liverdun, Pompey, une rivière calme, mais parfois en colère avec ses inondations et dégâts. J’aimais m’y retrouver souvent dans ma jeunesse loin de la pollution de l’usine métallurgique qui s’est installée en aval. Je vais essayer de trouver les mots pour retracer d’où je viens, il arrive souvent à un certain âge de chercher à retrouver ses racines et j’ai dû recourir à certains textes sur Pompey et l’implantation de son usine, l’abandon de la vigne, dans le livre de mon ami Lucien Geindre devenu chercheur et historien. Il a su explorer dans les livres anciens la vie de ce petit village qui comptait en 1860, 500 habitants pour monter à plusieurs milliers.
.......Pour mieux comprendre ce récit, il faut quelques détails que je vais essayer de vous résumer.
.......En 1850, Messieurs Dupont et Dreyfus possédant en Ardennes les forges d’Apremont et de Champigneulles, voulant s’agrandir, mais faute de place, achetèrent à Ars sur Moselle vers Metz une usine inachevée, où ils montèrent le premier haut fourneau au coke et un premier laminoir ; mais après la défaite de 1870, Ars-sur-Moselle devint Allemande. Les maîtres de forges transportèrent une partie de l’usine à Pompey à 12 km de Nancy sur un terrain en bordure de la Moselle ; les premiers travaux commencèrent en 1872. Beaucoup d’ouvriers quittèrent Ars-sur-Moselle dont mon arrière grand père Léonard et sa famille et s’installèrent à Pompey (Meurthe-et-Moselle). Rien n’avait été prévu pour les loger, il en arrivait toujours plus, il a fallu construire à outrance, pour loger en premier les familles ouvrières, les écoles, une Mairie, des routes, des magasins d’alimentation, une gare en 1876.
.......C’était une ville avec une usine qui tournait à plein régime. Vint la nouvelle guerre de 1914 puis celle de 1940. Elle commença à ralentir pour s’arrêter définitivement en 1986. Que de drames, plus d’usine, plus de travail, plus d’argent. Mon grand père y a travaillé comme puddleur. Cela consistait à aérer la fonte pour la transformer en fer, un métier à haut risque dans la chaleur infernale ; un jour mon grand père y a laissé sa vie en accident de travail. Ma grand mère a du trouver de quoi remplir la marmite dans une école de trois classes, pour le nettoyage des salles et s’occuper des petits, car à l’époque en 1898, les pensions, ni rien n’existait. C’était la grande misère dans tous les foyers pour survivre, et chez la grand mère il y avait trois filles et un garçon plus un enfant adopté avec un petit pécule de l’état. Il a grandi jusqu'à ses vingt ans dans la famille et les premiers jours de la guerre de 1914 s’est fait tuer. Tous les ans ma grand mère allait dans ce grand cimetière après Pont-à Mousson, elle revenait de plus en plus triste, combien de fois je l’ai surprise dans les années 26-35 à pleurer.
.......Je l’aimais tant ma pauvre grand mère, elle a marié ses enfants dans les années 1914 à 1920 et je suis venu au monde en 1922. Nous vivions serrés dans une grande maison séparée d'un couloir avec la propriétaire à côté, mais cela faisait du monde. Mon arrière grand père qui n’a pas voulu devenir Allemand vivait avec nous, la grand mère, mes parents, ma sœur née en 1920, mon frère en 1924 dans quatre pièces au 44 rue des Jardins-Fleuris à Pompey, maintenant la poste. Papa travaillait dur pour nourrir tout ce monde, maman sur sa machine à coudre tard dans la soirée, pas d’électricité dans les années 20, tout à la bougie et lampe à pétrole à faire de la confection pour un grossiste de Nancy. Tous les samedi un gros ballot noir sur son épaule, elle allait livrer par le tramway tout son travail de la semaine et revenait avec autant de marchandise à faire. Elle rentrait fatiguée, désabusée par le peu d’argent qu’elle ramenait. Ce n’était pas des francs, mais des sous, autrement dit des centimes, les parents comme tant d’autres ont miséré, et petit à petit sont sortis de cette misère, sans être trop riches à la fin.
.......J’ai parlé jusqu'à maintenant de ma famille côté maternelle, voici l’autre famille de mon père « votre grand père », je ne sais malheureusement pas grand chose, il venait d’Alsace né à Strasbourg en 1896 ; l’Alsace était annexée aux Allemands depuis 1872 et les frontières des Vosges étaient bien surveillées, et pourtant ils abandonnèrent tout ce qu’ils avaient et ils passèrent en France, comment ?
.......Je n’ai pas de détails à vous transmettre, les familles s’installèrent à Pompey, le grand père a trouvé du travail dans une ville proche comme gérant d’une succursale dont la maison mère était à Pompey, alimentation complète, il avait trois fils et ma grand mère. Papa s’est mis à la menuiserie ébénisterie dans l’aciérie de Pompey et a fini comme agent de maîtrise dans l’école d’apprentis de l’usine. Son frère Paul comme électricien, à quelques temps de sa vie d’ouvrier a été nommé contre-maître. Son autre frère le plus âgé, a fait des études d’architecte, fait quatre ans de guerre, est sorti lieutenant, a fait Madagascar - Djibouti. Il a travaillé à la ligne Maginot, une ligne de forteresses vers la frontière allemande mais non complète, beaucoup d’espaces non protégés que les Allemands ont mis à profit pour passer en quarante. Une nouvelle guerre venait d'éclater puis, occuper la France pendant quatre ans et cinquante millions de morts à travers tous les pays.
.......En 1925, mon arrière grand père Léonard, vivant avec nous, s’en est allé pour son dernier voyage.
.......En 1943, c’était le tour du grand père paternel Cadé Richard. Nous logions dans une grande maison, mais quatre pièces pour sept personnes, c’était un peu serré, mais à l’époque des années 20, c’était de vivre avec les parents et grands parents que nous respections, nous les enfants que nous étions. Maintenant, les vieux que nous sommes devenus, cela embarrasse. A la mort du proprio, la maison a été vendue et nous dehors. Nous avons retrouvé une maison neuve dans une cité ouvrière au 204 Rue Myrthil Dupont, c’était merveilleux, les bois de chaque côté, des prés, nous étions heureux. Nous y sommes restés jusqu'à la mort de votre grand mère en 1961 avec Jeannette et Maurice et grand mère Léonard Cornibé qui nous a quitté à son tour en 1948. Voici en gros la généalogie de ma famille qui des deux côtés n’a pas voulu rester Allemande.
.......Revenons maintenant à moi, votre père. Après la débâcle, votre grand père et moi sommes devenus chômeurs en 1940 sans indemnités, cela n’existait pas, l’usine était fermée. Pompey était pleine de verts de gris, à chaque instants des contrôles « ils aimaient cela » et nous les habitants nous ne les aimions pas. Dans la traversée de la ville il passait des milliers de soldats français à pied direction Metz et les camps en Allemagne, la nuit des centaines de chevaux prenaient le même chemin, tous ces bruits de sabots résonnaient. Beaucoup de chevaux étaient parqués de l’autre côté sur l’autre versant. Il y avait la Moselle et la Meurthe à traverser. Comme il n’y avait plus rien à manger dans la vi!le, pour certains plus débrouillards, la viande à portée de main, l’abattage clandestin de nuit a commencé. Retour en barques, distributions au voisinage, ces « bouchers » ne se sont jamais fait prendre, ni dénoncer. J'ai mangé du cheval, comme bien d’autres. C’était le commencement de la pénurie et des restrictions avec les combines du marché noir. La moindre parcelle de terre était mise en culture. Il fallait manger, plus de travail, l’usine fermée, plus d’argent, le moral au plus bas.
J’ai trouvé une place dans une ferme par l’intermédiaire de la mère à André Legrand qui habitait en face de chez mes parents. J’ai travaillé dans les champs, soigné les bêtes, il n’y avait guère de temps libre dans ce métier. Je rentrais à la maison avec du beurre, des œufs et un petit salaire en argent allemand d’occupation. L’usine a ouvert ses portes en octobre 1940 avec une direction allemande, des gardes et feldgendarmes avec leur grande plaque de métal sur la poitrine. Enfin nous étions bien encadré mais après deux mois de travail et de contrôle, la rébellion contre l’occupant, sabotage, la résistance avant l’heure commençait. J’y pris part, comme d’autres, trains déraillés, coulées de fonte ou d’acier en fusion sabotées, pneus crevés sur les routes. J’étais un spécialiste dans ce domaine avec le drapeau français hissé sur la plus haute cheminée, en fin d’occupation. Personne pour grimper là-haut, malgré les menaces, cela devenait malsain de rester avec eux. Avec un copain nous avons envisagé de filer en zone libre et un beau jour nous avons réussi à filer, c’était en janvier 1941. Il était tombé ce jour un verglas très épais, pas moyen de tenir sur nos jambes, mais nous étions équipés en crampons de tôle fixés sous nos chaussures. La nuit était là, et ce n’était pas un temps à mettre un Allemand dehors, mais ce jour un officier à voulu y goutter. Sa voiture une Renault Juvaquatre volée, a fini ses jours dans un platane. Personne autour, inspection de l’intérieur par nous deux, pleine de caisses de bonnes bouteilles et d’alcool, alors qu’il n’y en avait plus depuis six mois. Alors à nous la bonne soupe, chacun cinq ou six bouteilles, et de filer en vitesse, pas bien loin, car derrière nous les hurlements d’un individu qui avait tout vu, qui avait peur aussi. Il nous menaçait de nous dénoncer.Voyant cela nous avons fait demi tour pour reporter les bouteilles que nous glissions sous la voiture alors que l’officier Allemand était de l’autre côté.Tout d’un coup il était sur nous, et nous empoigna d’une main tous les deux avec un revolver sous les trous de nez, un engin énorme. Nous tremblions de froid et de peur, et il gueulait comme un cochon que l’on égorge, « Polizei - Gestapo » Trois heures comme cela, il attendait qu’une voiture Allemande passe pour nous embarquer, mais pas de chance pour lui, pas une seule ne s’est pointée ce soir là.
.......Je me souviens de ce gaillard habillé moitié en militaire et en civil, veste verte et chapeau Autrichien avec un petit paquet de poil, genre blaireau, mais son énorme revolver : pour nous, il était énorme. Nous étions toujours sous sa menace, et il nous tenait bien. A cent mètres à peine, un café tenu par un Alsacien, grand copain de mon père Dambach. Le voilà qui s’approche vers nous et commence à discuter avec le Fritz. Cela a duré un bon bout de temps. Un accord enfin; il a fallu emmener les caisses au café toujours sous la menace de son engin, il avait peur que nous filions. A un moment il s’est radouci : nos papiers, adresse, le tout recopié sur son calepin. Je vous le dis, nous n’en menions pas large, Que se sont-ils dit tous les deux ? je ne l’ai jamais su, même six ans après lorsque j’ai rencontré Mr Dambach à Nancy dans la rue St Jean. Nous grelottions toujours de froid et de peur, et brusquement l’officier déboucha une bouteille d’alcool, demanda des verres, « trincken - prosit », un salut et vite dehors, libres mais après cela nous avons préféré filer. Un autre voyage allait nous mener loin. A trois heures du matin : de train direction France libre. Mais où passait-elle cette frontière, ligne de démarcation? Pour nous c’était l’inconnue. Après plusieurs trains, contrôlés sans arrêt par les contrôleurs Français escortés par des soldats en armes, nous filions vers Epinal - Belfort. A chaque arrêt en gare,le train était encerclé des deux côtés, une centaine d’hommes en armes. Beaucoup de gens du train étaient raflés et remis aux soldats. Pour eux le voyage était terminé. Ils repartaient peu après vers les camps en Allemagne. Nous avons su plus tard ce que c’était ces camps. Comment nous avons passé , je n’en sais rien encore. Arrivés à Besançon, nous étions paumés. Assis sur un banc, où aller ? Quand une connaissance est venue vers nous, Mr Charleux de Frouard. Il m’avait reconnu. Il travaillait dans le service de l’oncle Paul en électricité. Il venait de la France libre et rentrait à Pompey, et là il nous a été d’un grand secours, des détails et le nom d’un passeur à Ivory. Il fallait prendre un bus jusqu'à Salin et le reste à pied vers le haut. Quelques kms et nous entrons dans une grande ferme, au même instant qu’une trentaine d’Allemands. C’était leur cantonnement et ils rentraient d’une journée de patrouille sur la ligne de démarcation. Le passeur est arrivé « Mr Henri Maire ». Il nous a dit de filer dans les champs de neige et à 22 heures, rendez-yous devant le seul café du coin, quelques maisons alentour, un hameau, c’était tout. Nous étions gelés et à l’heure dite en route dans la neige jusqu’aux genoux à travers bois, par un grand détour, car la veille une dizaine de gens s’étaient faits prendre. Nous n’en menions pas large, surtout qu’au loin les mitraillettes tiraient, les chiens se faisaient entendre, le mitraillage se rapprochait, les hurlements aussi. Plus vite réclamait le passeur qui n’était pas rassuré non plus, mais courir dans une neige aussi haute n’était pas facile. Les branchages nous griffaient de partout, les balles aussi nous sifflaient aux oreilles, j’en ai pris une dans le dessus de l’épaule, à peine une éraflure sur la peau, un peu de sang, deux centimètres plus bas ces salauds me foutaient l’épaule en deux. Enfin après bien des kms, à la sortie de la forêt, une pancarte « France libre ». Quelle joie pour nous, nous avions réussi à passer. Il a fallu payer le passeur. J’avais six cent francs sur moi, le copain autant, quatre cent chacun ont changé de mains, mais après une virée pareille, pas de discussions, trop heureux d’être en vie. Nous étions en vue d’un petit hameau à Valempouillère, premier village non occupé. Le café où nous sommes entrés était le lieu de rendez-vous des gens et filles de notre âge, qui attendaient le passeur, pour repasser dans l’autre sens. Plus d’une trentaine attendaient. Vite un café pour nous réchauffer, nous en avions besoin. Une dame du pays nous a hébergé pour la nuit dans un grand lit. Après deux jours sur les routes et deux nuits sans sommeil, en moins de deux nous roupillions, le cauchemar était terminé. Vers midi le lendemain, après avoir remercié cette dame, nous prenions le bus jusqu'à Lons le Saunier. Nous voulions travailler, mais le compagnon de Besançon nous avait mis en garde : des millions de réfugiés depuis juin 1940 étaient en attente de travail. Aussi pour nous, il n’y avait que l’armée pour nous nourrir. Dans une rue en pente, à Lons le Saunier en face de la gare, il y avait une caserne et le 151ème régiment d’infanterie. J’ai signé pour trois ans. Le copain de Pompey qui avait subi toutes ces épreuves, n’a pas été pris dans l’armée mais dirigé dans un camp de jeunesse. Nous nous sommes quittés à regret à Lons le 20 janvier 1941. Je l’ai revu après la guerre. Il a voulu remonter à Pompey. Il s’est fait prendre et à tiré trois ans en Allemagne. Je peux le dire maintenant, j’ai eu peur, mais quelqu’un au dessus de moi m’a protégé, ou alors une grande chance.
.......Je suis resté trois jours à Lons et ensuite Marseille. Je partais pour Casablanca au Maroc. Il fallait attendre un bateau pour Oran en Algérie. Plusieurs fois j’ai fait le chemin du camp Ste Marthe à Marseille où nous étions plus de cinq mille en attente dans des baraques avec des lits en planches, cinq par lit dans la paille et la vermine. De Ste Marthe via La Canebière à pied il y a un long chemin. Arrivé au quai de la Joliette pour embarquer, un dernier contrôle. Mais alors là, une surprise, c’était encore eux, des Allemands et Italiens. Chaque fois demi tour : trop jeune pour un réserviste, pas moyen d’embarquer. Après un mois de camp, des régiments de France libre venaient au camp pour nous influencer par leur propagande pour nous inciter à venir dans leurs divers régiments. Je n’en pouvais plus, mon argent avait fondu à force d’acheter de la nourriture, si bien que je suis parti dans un régiment de cuirassiers à Orange dans le Vaucluse où j’en ai repris pour trois ans, avec l’humiliation de revoir ces bottes et casquettes étrangères, qui venaient tous les mois, et contrôlaient tout, de la nourriture aux armes et munitions. Tout était comptabilisé. Moi qui croyait ne plus les voir, j’étais servi, la France demie libre, voici sur quoi j’étais assis. Je suis resté à Orange quatre mois après avoir fait mes classes et un entraînement de quatre vingt kms par jour, souvent le Mont Ventoux et toujours le mistral qui nous couchait avec le vélo et tout le barda dessus plus les armes. Moi, j’avais un fusil mitrailleur. Ça a été terrible, mais je l’avais voulu. J’écrivais à mes parents par l’intermédiaire de votre future maman, qui me passait mes lettres dans son guidon de vélo et passait le pont sur la rivière le Doubs qui coulait à cinquante mètres de leur maison. Après de l’autre côté c’était la France occupée. J’avais eu son adresse par un copain de Pompey qui avait comme moi quitté le pays en 1940 en juin. Ils avaient été plus loin que moi et un beau jour se sont retrouvés à Sermesse en bordure de la ligne de démarcation, chez la famille Desbois qui les a accueillis et retapés pendant quelques jours. En repartant, échange d’adresses, et c’est par le propre cousin de Dédé, Paul Hinzelin de Rosière ; qui était hébergé à Sermesse, que j’ai eu l’adresse de votre future maman, ce qui m’a permit de correspondre avec elle, puis de venir passer ma première permission de huit jours. Et un beau jour, permission en poche par le train Orange Lyon, changement de train à Bourg en Bresse et Navilly. Il n’allait pas plus loin, la ligne de démarcation était à cent mètres, ensuite à pied jusqu'à Sermesse six ou sept kms. C’était un dimanche vers onze heures. Devant moi dans le village, un attroupement, des gens du pays étaient rassemblés devant l’église en attendant le curé pour la messe. Ils étaient stupéfaits de voir un militaire français si près de la ligne, car ii existait une zone de trente kms en retrait où il ne devait pas y avoir de militaires, et moi, j’étais là devant l’église. Une jeune fille de dix sept ans s’est avancée. Nous avons fait connaissance et embrassés devant tous. Ce jour là pas de messe pour votre future maman. J’ai été reçu ensuite par ses parents, les repas ensemble et j’ai couché dans une maisonnette en face de chez eux où mes copains de Pompey en 1940 avaient séjourné. Aujourd’hui, je repense à eux cinq, tous disparus pour leur dernier voyage. Huit jours de bonheur et de vie familiale, cela m’a requinquer, j’en avais besoin. Voilà comment j’ai connu votre future maman. Ensuite retour à Orange, mais j’avais envie d’aller plus loin. J’ai fais une demande pour la Syrie via le Liban.
.......Je devais partir de Lyon, Strasbourg et Zagreb en Croatie, où nous devions partir en avions, mais le jour du départ un contre ordre, la guerre là bas était terminée. Je suis donc rentré à Orange. Une nouvelle demande pour le Tchad. Nous sommes parti cinquante hommes et officiers, retour au camp St Marthe deux jours et là embarquement (3.8.41) à la Joliette ; pas d'Allemand ce jour ? Pourquoi ? arrivés à Oran (5.8.41) où nous sommes restés deux jours, ensuite le train vers le Maroc. Un premier arrêt à Sidi Bel Abbès. Les Arbis nous ont volé. Ça commençait bien dans un pays nouveau pour nous. Ensuite arrêt à Oujda à la frontière du Maroc à la Légion Etrangère où nous avons stationné deux jours, le temps de passer à l’épouillage, les uniformes passés à la vapeur, douches pour tous. Le lendemain au réveil, la moitié de nos frusques avaient disparu. Les Arbis avaient tout fauché pendant la nuit, si bien qu’en arrivant à Rabat le 10.08.41 pour se rendre à pied au 1er régiment de Spahis, il a fallu faire venir un camion de l’armée pour nous transporter, car nous étions plus ou moins en slips, mais quel boulot pour les déclarations de vol et nous rhabiller. Un mois à Rabat, un mois d’entraînement, école de conduite. Je n’avais jamais conduit, et l’on me colle un camion, camion que j’ai manqué de foutre à la mer, le camp était en bordure sur la route vers le palais royal du Sultan. Ensuite Casablanca en attendant un bateau pour Dakar. La grande aventure commençait, huit jours de traversée. Le 21.09.41, du Sénégal, nous avons passés au Soudan, maintenant le Mali, mille cinq cent kms de train dans un pays nouveau, où les hommes et femmes moitiés nus vivaient dans une chaleur infernale, les odeurs aussi. Il ne fallait pas les approcher de trop près. Ils puaient, une graisse naturelle le Karité. Ils s’en servaient pour tout, de la cuisine au graissage des corps, et l’éclairage en lampe à huile. Arrivée à Bamako, le train n’allait pas plus loin, ensuite trois cent kms en camions sur une piste pleine de trous et la poussière. Nous étions jolis à l’arrivée jusqu'à Ségou où je suis resté quelques mois. Plus de Tchad, Leclerc remontait vers la Lybie avec tout son régiment, et nous à Ségou, le 29.09.41. Il arrivait toujours plus de jeunes évadés de France. Il a fallu couper le régiment, le huitième chasseur d’Afrique en trois, une partie au Niger à Dosso, l’autre au Cameroun à Douala, où j’ai séjourné plusieurs fois. Seize mois dans ce pays, c’était à en perdre la raison, un pays envoûtant et nouveau pour tous, difficile de s’y adapter, le climat, les tornades de sable, les bestioles, crocos, lions, serpents, la fièvre, le soleil, les termites qui m’ont bouffé en une nuit la moitié de ma moustiquaire, pour un peu ils m’auraient bouffé. A onze heures du matin, arrêt d’activité, plus moyen de tenir, surtout dans les baraques en tôles, une fournaise, la sueur partout, de l’eau tirée directement au Niger, pleine d’Amibes, dysenterie pour tous, nourriture ; du riz à l’eau midi et soir, même du maïs en grain que nous avons refusé et porté nos gamelles au mess des officiers. Les cachets à avaler de force et contrôlés, quinine blanche, quinakrine, prémaline jaune. J’écrivais toujours à votre future maman et un beau jour de novembre 1942, une lettre de rupture. Elle en avait plus que marre de me voir cavaler à travers le monde. Quelle tristesse pour moi cette séparation, surtout où j’étais : pas de perm pour nous à cause de la guerre. Les Allemands ont pris le reste de la France libre. Il a fallu un jour de février 1943 quitter l’Afrique en y laissant deux cent cinquante morts de maladies, une délivrance ce jour. Retour à Dakar, embarquement sur un bateau de luxe « Le Colombie ». Je ne pesais plus que quarante trois kilos.
.......Dans ce bateau de luxe, nous avions, pour dormir des matelas en mousse, et les repas dans des salle à manger en première classe, services en argent, un vrai paradis, et bien nourris surtout, la TSF à bord où un beau jour, radio-Stugard annonçait que le« Colombie » transportant notre régiment de chasseurs d’Afrique, une partie de légionnaires, des aviateurs venait d’être torpillé et coulé. Une vraie rigolade à bord, mais ils avaient un sacré service d’espionnage en Afrique. A seize heures, les avions ; ils ne nous ont pas loupés, deux bombes sur l’avant du bateau. Quelques tués et blessés, nous étions au large de la Mauritanie. Arrivée à Casablanca, débarquement pour tous. Beaucoup de casse dans le port : des bateaux de guerre bien endommagés dont le cuirassé « Jean Bart », un trou dans le blindage de la coque au raz de l’eau, l’on pouvait y entrer en gros camion tellement c’était gros.
.......Huit jours à Casa et en convoi pour nous escorter vers Gibraltar, dans un petit bateau le Sidi Brahim, un transporteur de moutons. Ça puait partout. Après bien des jours, et un nouveau torpillage devant nous, « l'Athoss 2 », les bateaux de guerre zigzagaient entre nous, grenadage sans arrêt. Arrivée à Oran, et à quarante kms dans le sud, repos pendant six mois, et ensuite équipés en Américain, départ pour une partie vers Alger à Cherchel pour toucher les chars et camions, école de conduite et de dépannage pour quelques uns et en route vers Oran. Il y a un long trajet, cela longeait la mer en partie. Ensuite départ pour le sahara pour trois semaines de manoeuvres et tir, ensuite manoeuvre vers Mers et Kébir, pour apprendre à rouler dans la mer vers les bateaux, vers le 27.10.43 à Arzew. L'Italie après, dans les montagnes des Abruzes. Cela n’a pas été tout seul, surtout devant Cassino. Un jour, les avions, une centaine de forteresses volantes, débourent dans le ciel, et lâchent leurs pruneaux sur un hôpital Américain, une erreur de tir de la première vague.C’était à huit cent mètres de nous, j’y suis allé: que de morts et des trous énormes. Après bien des jours, arrivée en Toscane. Que c’est joli ce pays. Ensuite retour à Naples par la côte, puis l’embarquement pour la France, pas assez de bateaux pour cent vingt mille hommes plus le matériel. Ils sont venus nous rechercher quinze jours après, où nous avons débarqué le 23.09.44 dans la rade de Toulon, au milieu des carcasses de bateaux de guerre sabordés en 1942.
.......J’ai retrouvé une partie du régiment vers Toulon, ils avaient avec d’autres libérés la côte jusqu’à Nice, ensuite la poursuite pour eux, par la Vallée du Rhône, nous, par la montagne, la route Napoléon jusqu’à Belfort, où nous ne pouvions passer. Je suis resté à Lures quelques jours où j’ai profité de la voiture de l’aumonier qui voulait revoir sa famille à Nancy. Arrivé devant la Moselle séparant Frouard et Pompey, les Allemands avaient fait sauter le pont, la deuxième fois en quatre ans. Moi je voulais aussi revoir ma famille, je suis donc passé par le pont du chemin de fer à deux cent mètres, qui lui aussi avait sauté. Les Américains étaient en train de le remettre provisoirement en état de supporter le matériel roulant. J’étais dans un état second de revoir mon pays, et aussi les ruines, tout avait sauté vers les ponts.
.......A peine en vue de la cité, mon frère dans la rue m’a repéré et appelé maman. Nous avons courus l’un vers l’autre pour nous embrasser, mais ma pauvre mère n’était plus qu’une ombre, trente kgs en moins, elle flottait dans ses habits, et tous les gens qui m’entouraient étaient dans le même état, quelle tristesse et quelle joie de les revoir. Mon frère a été chercher papa à l’usine, je n’avais qu’une heure de perm en quatre ans, et c’est à la maison que nous avons parlé de tout, que votre future maman à toujours été en contact avec mes parents qui recevaient de temps à autre des produits de la ferme. Sa famille avait déménagé dans une autre ferme dépendante du château de la Comtesse de Varax, quelque chose d’important, mais aussi une mauvaise nouvelle dans sa famille. Son père et son frère Henri ont été raflés avec une dizaine d’autres dans le village de Montcoy, un seul est revenu, pour les autres c’était la mort. Cela m’a peiné, et à peine retourné à Lures, j’ai renoué le contact avec elle. Un mois après je suis passé les revoir. J’allais à Lyon, changer un moteur sur un camion, les gars l’avait saboté pour revoir leur famille à Lyon. Au retour, je suis repassé et c’est dans mes bras que nous avons signé notre accord de faire une famille. Mais la guerre n’était pas terminée et c’est seulement huit mois après que nous nous sommes mariés. J’avais un mois de perm. Au retour une surprise, j’étais inscrit pour l’Indochine d’office, mais là, je n’étais plus d’accord, mon contrat de réengagement prenait fin. Je n’ai pas signé un nouvel engagement de deux fois deux ans, je me suis fait démobiliser le premier août 1946. Adieu l’armée, presque six ans. Je suis donc revenu à Pompey préparer un logement au 14 rue des Jardins Fleuris que mes parents nous avaient trouvés. Ensuite de retour à Montcoy chercher votre future maman, et nous installer dans notre appartement. J’ai trouvé du travail dans un garage à Nancy, déplacement par le train et tram. Mon état de santé n’était pas brillant. Il a fallu repartir en Saône et Loire où nous y avons fait une rude bataille pour survivre, surtout trouver un logement, trois garnis sales et vermine partout, mais nous n’avons pas baissé les bras, nettoyage, désinfection, surtout pour notre premier enfant. Notre vie à St Marcel a commencé. Henri Paul est venu au monde le 31 juillet 1947 dans la joie de nous deux. Entre temps j’avais trouvé du travail comme mécano aux autobus de St Marcel, mais pas trop payé, nous viviotons. Malgré cela, nous étions heureux d’être ensemble. Quelques années après, c’était le tour de notre fille Josiane le 31 octobre 1952. J’avais trouvé un autre travail, mon salaire allait mieux, triplé depuis Nancy, mais nous n’étions pas chez nous, si bien que nous avons envisagé une construction à Chatenoy le Royal, une petite maison en rapport avec notre budget au 24 rue de la République. Une maison pour nous quatre, il a fallu batailler dur pour y arriver et surtout vous élever en dehors de la vermine. Nous étions enfin chez nous, mais pour nous maintenir dans notre chez nous, que d’heures passées dans le travail, le bruit, la saleté. Mes nerfs en prenaient un coup, mon caractère changeait, surtout lorsque les enfants sont devenus adolescents et exigeants. Que de colères que votre maman a su me calmer, Vous aviez où plutôt vous avez une bonne maman et une bonne épouse pour moi ; je l’ai aimée depuis 1941. Mariés en 1946, elle en a vu à mes côtés, elle a toujours fait face aux pires ennuis qui nous sont tombés dessus, elle a travaillé dur dans cette maison, le jardin en plus des tâches ménagères. Vous n’avez jamais manqué de rien, toujours levée avant vous pour vous préparer et emmener à l’école, c’est une mère dévouée.
.......Je vais terminer ce long bavardage dans ce long voyage de notre vie, je vous ai tout dit dans les grandes lignes, car pour les détails il y en aurait autant à dire et à écrire, et puis vous en avez assez pour aujourd’hui. Je me demande si vous aurez le courage de tout lire, mon cerveau est vide. Ainsi s’achève mon très long voyage dans ma mémoire.
............................................................................................Votre père.
J’ai écrit cela en 2001
.......Je retrouve le 4 partout, même à l’atelier le 34. Pour plus de détails sur Pompey et son usine, mon copain d’école est devenu historien. Nous sommes restés toujours amis et m’a dédicacé son livre sorti en 1981. Pompey sous l’avant garde, étude historique de Lucien Geindre. Je vous conseille de le lire.
